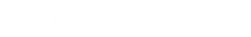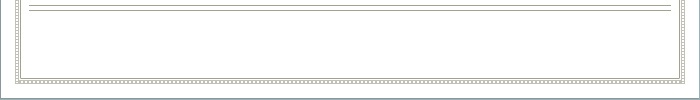French 331:


French 331:

La poésie lyrique d’expression française
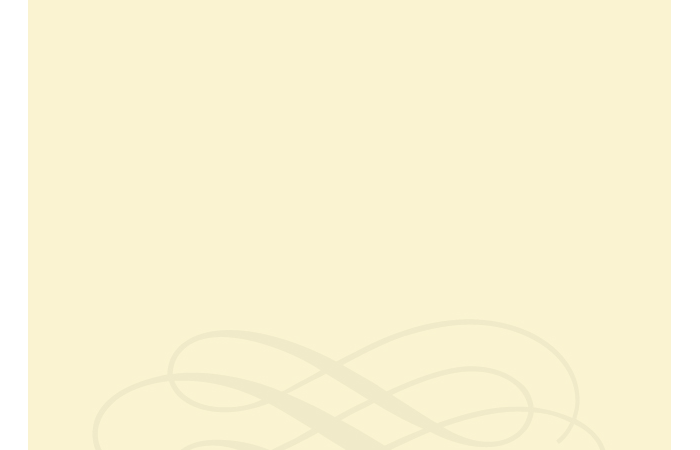
Évaluation.
Ce cours vous demandera une préparation journalière attentive. Vous aurez souvent des questions de lecture à compléter et je m’attendrai à ce que vous preniez part à la discussion de manière informée et intelligente. Vous aurez droit à 3 absences sans une baisse automatique de 2% de votre note finale. Cela va sans dire que je vous tiens responsable de tout travail manqué par absence.
Puisque l’interprétation de la littérature entraîne une écriture soutenue vous aurez 4 analyses à rédiger en plus d’un texte créatif. Votre travail comportera en plus un examen de mi-semestre et deux présentations orales accompagnées d’une rédaction. Tout travail doit être complété pour la date indiquée à moins de me prévoir à l’avance en cas d’urgence.
Préparation journalière:15%
Analyses de 2- 2 ½ pages (4 + travail poétique):30%
Examen de mi-semestre :15%
Exposé sur l’art visuel + rédaction:15%
Présentation finale:10%
Rédaction finale (de 6 à 7 pages):15%
Textes à lire.
An Introduction to Old Occitan. William D. Paden (The Modern Language Association of America, 1998). [extraits]
Littérature (textes et documents) : Moyen Âge-XVIe siècle. Anne Berthelot & François Cornilliat (Paris : Éditions Nathan, 1988). [extraits]
*Dictionnaire de poétique. Michèle Aquien (Paris : Librairie Générale Française, 1993). [extraits]
*Poètes français des XIXe et XXe siècles. Préface de Serge Gaubert (Paris : Livre de poche, 1987).
*Capitale de la douleur suivi de L’amour la poésie, Paul Éluard. Préface de A. Pieyre de Mandiargues (Paris: Gallimard, 1966).
*Capitale de la douleur, Paul Éluard. Parcours de lecture par Jean-Pierre Longre (Paris : Bertrand Lacoste, 1990).
*Surrealism, The Road to the Absolute, Anna Balakian. (University of Chicago press, 1986).
*Rythmes, Andrée Chedid. (Paris : Gallimard, 2003).
(*Textes à acheter. Les autres textes se trouvent à la bibliothèque et je vous donnerai en classe les pages à étudier.)
Description du cours.
En prenant comme point de départ les points soulevés par l'aperçu historique ci-dessous, nous chercherons à travers l'étude de divers textes d'expression française à approfondir notre connaissance de la poésie lyrique et à en formuler une définition qui soit apte à notre époque ainsi qu’à nos vies.
Une définition de la poésie lyrique
Le poème lyrique se présente comme le lieu par excellence du JE, qui y manifeste sa relation au monde, à la nature, à l'Autre. Variations sur les thèmes de l'amour et de la mort, de la joie et de la douleur. La poésie lyrique garde, à travers toute son évolution, la même visée radicale: atteindre un au-delà du monde, un absolu. Le poète cherche, par des textes de forme savante ou populaire, à donner une portée plus grande à son expérience individuelle, à transcender sa condition d'être humain. Le lyrisme s'épanouit dans une société et dans une littérature qui accordent une grande importance à l'individu, à sa liberté d'expression et de passions. Il s'accommode mal des règles et des lois de la raison. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'en France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, il n'y ait pratiquement pas eu de poètes lyriques: la doctrine classique avait complètement étouffé le lyrisme. C'est la Révolution française qui fait renaître le lyrisme en faisant tomber les dogmes classiques et en annulant les hiérarchies; l'individu reprenait alors une place de premier plan. Le rôle et le statut du poète lyrique changent d'une époque à l'autre et d'une société à l'autre. Dans l'antiquité, en Grèce et à Rome, le poète est engagé dans la vie de la communauté à laquelle il appartient. Il est sur la place publique et s'adresse directement à ses contemporains, il en est le porte-parole, le guide spirituel; il jouit d'un grand prestige, on le comble d'honneurs (e.g. Pindare). Au Moyen Âge, le poète lyrique occupe aussi une place de choix: il est au service des seigneurs, il écrit pour divertir une élite oisive. Mais il n'a pas toujours une situation aussi favorable. Par exemple, au XIXe siècle, en France, il devient un solitaire, un exilé, un homme qui vit hors du monde, dans la pauvreté: c'est le poète maudit. Il occupe une place à part et n'est au service de personne (e.g. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud). Encore de nos jours, le poète lyrique est refoulé dans les marges. Le rôle qu'il joue dans la société est considéré comme négligeable.
L’origine et l’évolution de la poésie lyrique
La poésie lyrique est issue des prières et des hymnes religieux. A ses débuts, elle avait pour fonction d'exprimer les sentiments d'un groupe, d'une collectivité. Elle était alors très proche de la musique, du chant. Quelques-unes des plus anciennes formes du lyrisme grec étaient des chants choraux: leur objet était la célébration des dieux, mais aussi et surtout des héros, des événements qui ont marqué la collectivité. À travers cette célébration, c'étaient les valeurs qui régissaient la collectivité que l'on exaltait. Les textes étaient donc empreints de morale, de sagesse.
Le lyrisme a beaucoup évolué par la suite, autant dans le contenu que dans la forme. Il est devenu plus personnel, il s'est mis à exprimer les sentiments de l'individu. Sapho compte parmi les premiers poètes à avoir donné une place centrale aux événements intimes de l'individu. Mais son lyrisme gardait quand même un caractère collectif: le poète, en parlant de lui-même, de ce qu'il vit, parlait au nom des autres. Ce caractère collectif, omniprésent au début, va disparaître petit à petit au fil des siècles, réapparaissant à l'occasion, par exemple, de bouleversements politiques et sociaux. Le texte lyrique varie dans son contenu au gré des auteurs et des époques: il peut être philosophique ou métaphysique (interrogations sur l'être et sa présence au monde) comme chez Hölderlin, sensuel, en prise sur les sensations, sur la réalité concrète comme chez Apollinaire, onirique comme chez Nerval, engagé socialement comme dans les débuts du surréalisme. La forme que prend le texte lyrique est elle aussi très variable: chanson (couplets et refrain), sonnet, poème en vers réguliers, poème en vers libres, etc. Mais, à travers cette grande diversité de formes, le but de la poésie lyrique reste le même: exprimer les sentiments de l'individu, une vision du monde unique, par un travail sur la langue, sur le rythme et les sonorités. (Copyright 1998 C.A.F.E.)
Références:
La poésie lyrique des origines à nos jours, Léon Levrault. (Paris: Mellottée).
La poésie lyrique au moyen âge, Guillaume Picot. (Paris: Nouveaux classiques Larousse, 1965).
hhttp:/www.cafe.umontreal.ca/genres/n-poelyr.html
Emploi du temps
I. Semaine du 27 au 31 août
1. Introduction au cours: Les origines de la poésie lyrique : la poésie des troubadours.
2. Littérature (textes et documents) : Moyen Âge-XVIe siècle: Guillaume de Poitiers, p.42 (photocopie) ; La Comtesse de Die : « Il me faut chanter ».
3. Ballade anonyme : « Je suis jolie » (photocopie).
II. Semaine du 3 au 7 septembre
1. An Introduction to Old Occitan: Jaufré Rudel, pp.136-7, 534-35 (photocopie).
2. Moyen Âge-XVIe siècle : Bernard de Ventadour, pp.43-44 + Old Occitan, 159-69, 538-9 (photocopie).
3. Moyen Âge-XVIe siècle : Fin’amor et courtoisie, p.45, (photocopie) + vidéo.
III. Semaine du 10 au 14 septembre
1. Moyen Âge-XVIe siècle: Marie de France, pp.92-94 (photocopie).
2. Christine de Pisan, pp.178-80 (photocopie).
3. Charles d'Orléans, pp.183-91 (photocopie).
IV. Semaine du 17 au 21 septembre
*Analyse 1 : La poésie du Moyen Âge
1. Poètes français des XIXe et XXe siècles. Préface, pp.5-9 ; Aux sources de la poésie moderne : le romantisme, pp.13-14 ; Lamartine, « L’isolement », pp.15-17.
2. Hugo, « Le manteau impérial », pp.25-26, « Demain dès l’aube », p.28.
3. Nerval, « Fantaisie », pp.32-33, « El Desdichado », p.34.
V. Semaine du 24 au 28 septembre
1. Le Parnasse, pp.35-36 ; Gautier, « L’Art », pp.41-43.
2. Baudelaire, pp. 45-46, « L’albatros », p.47, « Correspondances », pp.48-49, « Invitation au voyage », pp. 52-53.
3. Baudelaire, « Le port », p.55 ; « La chevelure », « Le balcon » (photocopie) Du romantisme à la modernité, pp.173-184.
VI. Semaine du 1er au 5 octobre
1. Innovations, révolutions, pp.57-58 ; Verlaine, « Mon rêve familier », p.59, « Art poétique », pp.62-63.
2. Rimbaud, « La lettre du voyant » (photocopie), « Ma bohème », 69-70.
3. Rimbaud, « Le bateau ivre », pp.70-74.
VII. Semaine 8 au 12 octobre
*Analyse 2 : La poésie du XIXe siècle
1. Le symbolisme et ses prolongements, pp.79-80 ; Valéry, « Les pas » p.84.
2. Balakian, Surrealism : The Road to the Absolute, pp.37-49.
3. Poètes français, L’esprit nouveau, pp.95-96 ; Apollinaire, « Le pont Mirabeau », pp.97-98, « Cœur couronne et miroir », p.102 ; Balakian, pp.80-99.
VIII. Semaine du 15 au 19 octobre
1. **Examen de mi-semestre
2. Poètes français, Tzara, « Chanson dada », pp.105-107 ; Reverdy, p.108 ; Balakian, pp.100-120 + Les épaves du ciel (extraits).
3. Poètes français, Breton, « Tournesol », pp.109-110 ; Jouer avec le langage, pp.111-112 ; Balakian, pp.123-169.
IX. Semaine du 22 au 26 octobre
1. Balakian, pp.170-209. Poètes français, Le poids de l’histoire, pp.127-128 ; Aragon, 135-136 ;
2. Balakian, pp.213-230. Éluard, Capitale de la douleur, pp.52-54, 56, 133, 175.
3. Exposé; Éluard, Capitale de la douleur, pp.115, 134, 135, 136, 137.
X. Semaine du 29 octobre au 2 novembre
1. Éluard, Capitale de la douleur, pp.139, 140-141;
2. Capitale de la douleur, pp.96, 97-98 ; exposé.
3. Capitale de la douleur, p.106; Capitale de la douleur, p.124.
XI. Semaine du 5 au 9 novembre
*Analyse 3 : XXe siècle
1. Exposé; Jacques Brel : chansons.
2. Exposé; Jacques Brel : chansons.
3. Exposés.
XII. Semaine du 12 au 16 novembre
1. Rythmes, Andrée Chedid.
2. Exposé; Rythmes, Andrée Chedid.
3. Exposés.
VACANCES DE THANKSGIVING
XIII. Semaine du 26 au 30 novembre
1. Poètes français des XIXe et XXe siècles, La poésie : une perpétuelle définition, pp.139-140 ; Saint-John Perse, pp.141-142 ; Eugène Guillevic, pp.147-149.
2. Présentations finales.
3. Présentations finales.
XIV. Semaine du 3 au 7 décembre
*Analyse 4 : Une voix de la poésie francophone
1. Présentations finales.
2. Présentations finales.
3. Présentations finales.
*Rédaction finale due le jeudi 13 décembre avant 16h.
Statements of University Policies
Disability Statement
Any student who feels that he or she may need an accommodation based on the impact of a disability should meet with me personally to discuss his or her specific needs. I rely on the Office of Academic Support & Enrichment Center in 104 Doane to verify the need for reasonable accommodations based on documentation on file in their office.
Academic Integrity
The students and faculty of Denison University and the Department of Modern Languages are committed to academic integrity and will not tolerate any violation of this principle. Academic honesty, the cornerstone of teaching and learning, lays the foundation for lifelong integrity.
Academic dishonesty is, in most cases, intellectual theft, whether inadvertent or intended. It includes, but is not limited to, providing or receiving assistance in a manner not authorized by the instructor in the creation of work to be submitted for evaluation. This standard applies to all work ranging from daily homework assignments to major exams and papers. Students must clearly cite any sources consulted—not only for quoted phrases but also for ideas and information that are not common knowledge. Neither ignorance nor carelessness is an acceptable defense in cases of plagiarism. It is the student’s responsibility to follow the appropriate format for citations.
As is indicated in Denison’s Student Handbook available through mydenison.edu, instructors must refer every act of academic dishonesty to the Associate Provost and violations may result in failure in the course, suspension, or expulsion. (For further information, see http://www.denison.edu/student-affairs/handbook/article7.html.)
Grading scale
A: 93-100
A-: 90-92
B+: 87-89
B: 83-86
B-: 80-82
C+: 77-79
C: 73-76
C-: 70-72
D+:67-69
D: 63-66
D-: 60-62
F: 59 and below